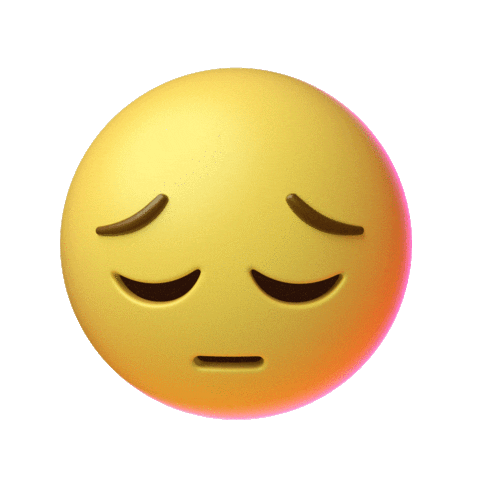C’est (presque) fini
Merci à tou·te·s de nous avoir suivi·e·s.
Créé fin 2015, Underlined avait pour projet de réunir des rédacteur·ice·s passionné·e·s pour parler de sujets qui nous tenait à cœur.
A titre personnel, je ne regrette rien. Que ça soit de se retrouver en note de bas de page sur Wikipédia, de se clasher plus-ou-moins stérilement avec Caljbeut ou New School ou encore de lancer un projet de podcast inabouti, tout m’aura servi et appris.
Seulement, entretenir un site, même sans nouveaux articles, c’est de l’énergie. Se conformer aux évolutions légales et techniques, payer l’hébergement, est-ce que cela à du sens quand le site n’est parfois pas visité une fois en 24 heures ?
Un peu résigné, j’ai changé mon fusil d’épaule. J’essaie aujourd’hui de partager autour de mes sujets sur YouTube, Twitter, TikTok et même via la fiction. D’autres de l’équipe sont devenu·e·s scénaristes, journalistes, prof ou chômeur·se.
Un peu attristé de voir internet se rétrécir, un peu dépité de ne savoir qui accusé sinon l’époque et moi-même, je n’ai plus le cœur à maintenir le site en vie.
Enfin… J’ai quand même archivé les articles au cas où…
D’ici-là vous pouvez retrouver nos travaux sous différents liens.
Merci à tou·te·s du soutien que vous nous avez témoigné durant toutes ces années.
A bientôt,
Au revoir Beri
Gaspard